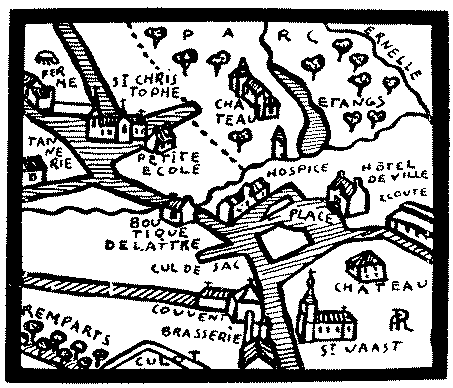L'INDÉPENDANCE BELGE (de 1830 à 1914)LA VIE ÉCONOMIQUEAprès la révolution belge, notre ville allait connaître une longue période de tranquillité ; elle permit un important développement économique. Alors que les communes voisines telles que Leernes, Landelies, Souvret, Monceau et Marchiennes possédaient chacune moins de 1.000 habitants en 1831, la ville de Fontaine-l’Évêque comptait déjà une population de 2.847 âmes. Sa superficie de 1144 hectares n'allait plus se modifier ; par contre, sa population allait s’accroître régulièrement et l'industrie cloutière s'épanouir par l'introduction en Belgique de machines pour la fabrication de pointes de Paris et de clous de petites dimensions. En 1830, une fabrique mécanique s'établit rue du chemin de fer et dura jusqu'en 1890. En 1833, se créa une « affinerie » fabriquant le fer en barres et les socs de charrues ; 60 petites forges pour la production de clous et de chaînes occupaient chacune 5 ouvriers. En même temps se fondait, grâce à de Haussy, une clouterie mécanique sur la place du Marché dans l'ancien couvent des Récollectines ; elle devait durer jusqu'en 1923. En 1842, apparaît la société des clouteries Otlet affermée dans la suite à la société « Clouterie des Flandres » ; cette fabrique commença avec deux métiers dans une forge qui était située dans l'actuelle rue L. Delattre. En 1857, s'ouvrit la clouterie Baudoux au bas de la rue de Haussy, à l'emplacement du jardin du café « Au Phare ». Elle se transplanta ensuite rue du Chemin de fer. En 1864, à côté de 42 petits ateliers de cloutiers se créent quatre nouvelles clouteries : la société Lemal, rue du Chemin de fer ; la clouterie Baillieux, rue de Binche, emplacement des maisons 56, 58, 60 : les clouteries Roelandt, rue des Houillières et l'établissement Castin, sur les Perziaux. À cette époque, trois marchands de clous étaient particulièrement connus ; leurs noms résonnent encore familièrement aux oreilles des Fontainois : M. Fosselart, grand-rue (actuellement maison R. Hennaut) ; M. Delcourt, rue de Binche, dont le métier est continué par ses descendants ; M. Delporte, rue d’Assaut. En 1870, était créée la S.A. des clouteries mécaniques ; en 1876, les usines Dercq et en 1887 la société en commandite Léandre Henne. En 1898, s'installe « La Fontainoise » qui implanta en Belgique la fabrication des vis à bois et en 1907, la société coopérative « L'Espérance », rue du Repos. Jusqu'en 1914, les clouteries fontainoises jouirent dans le pays d'un monopole quasi inattaquable ; les procédés de fabrication, jalousement gardés, étaient transmis de père en fils et les industriels locaux faisaient des affaires d'or. Parallèlement se développaient à Fontaine, l'extraction de la houille et l'industrie de la pierre à chaux. En 1839, le Conseil communal donnait l'autorisation à Pierre Cambier, négociant, de construire un four à chaux le long du chemin de Fontaine à Leernes : en 1840, Augustin Sottiaux, maître de carrières était autorisé à établir un four à chaux au hameau des Gaulx. En 1842, Antoine Bouly en établissait un au Tienne Alarmont ; en ce même endroit, les sieurs Anique Frères recevaient l’autorisation d’en construire un autre en 1847. Enfin en 1849, Monsieur Antoine Bouly en édifiait un dans une carrière qu'il possédait à un endroit appelé l'Enfer (rue Henrichamps). En ce qui concerne la houille, quelques « cayats » furent d'abord en activité : la fosse Robert (1834 à 1841), la fosse de la Pompe (1845-1851), la fosse de Metz (1857), la fosse Pain et la fosse Ste-Françoise. Les « cayats » étaient des sortes de grands puits au fond desquels les ouvriers mineurs exploitaient les veines. Ces puits étaient surmontés d'un treuil à manivelle qu’actionnaient deux femmes ou deux enfants. La chaîne se terminait par une espèce de tonneau dans lequel on descendait le mineur : c'est dans ce même tonneau que le charbon extrait était placé et remonté. Ce n'est qu'en 1866 qu'une véritable exploitation fut organisée par la S. A. des Charbonnages de Fontaine-l'Évêque. Dès 1863, Augustin Dufranne avait pratiqué des sondages et commencé le creusement d'un puits. En 1866, il fit une demande de concession en compagnie de Mesdames Palmyre et Sidonie Leroy de Seneffe qui apportaient le terrain dans lequel avait été commencé le creusement des deux puits du siège numéro 1 (Pétria). Cette première société, dite Société Houillière de Fontaine-l'Évêque se transforma le 30 mai 1874 en société anonyme des Charbonnages de Fontaine-l'Évêque.
Elle acquit en 1869 la concession de Beaulieusart qui comprenait 590 hectares sous les communes de Fontaine-l'Évêque, Leernes et Anderlues et en 1872, la concession de Leernes-Landelies. Le puits numéro 1 créé en 1866 au Pétria ne mesurait que 2,20 m de diamètre et servait de retour d'air : un second puits destiné à l'extraction fut commencé en 1867. En 1868, fut installée une machine d'extraction à vapeur tandis que débutait le creusement du premier bouveau de recherches au niveau de 200 mètres. En 1869, fut installé le premier ventilateur Guibal ainsi que les grilles de criblage ; on passa à l'extraction du charbon qui coûtait : · tout venant, pris à la fosse : 13 frs la tonne · mis à wagon : 14 frs la tonne · vendu au détail : l5 frs la tonne. Le transport des charbons de la mine à la gare de Fontaine-l’Évêque se faisait par chevaux ; mais, dès 1870, une convention fut établie pour la construction d'un raccordement du siège numéro 1 à la gare. Fin 1871, le Conseil d'Administration décida la construction de 50 maisons ouvrières pour les mineurs le long de la route de Mons (Coron du Cantonnier). En 1873, fut décidé l'établissement d'un second siège d'extraction au lieu dit « Calvaire » à la limite des communes de Fontaine et d'Anderlues ; le creusement du puits d'aérage du siège numéro 2 débuta le l5 juillet 1875 et celui du puits d'extraction l'année suivante. Dès 1879, commença le raccordement de ce siège à la gare d'Anderlues. Le 17 avril 1888, un coup de grisou au numéro 1 fit 14 victimes parmi les mineurs, tandis que le 9 décembre 1889, un dégagement instantané de gaz au bouveau sud de 497 m au siège numéro 2 fit 5 autres victimes. A la suite de cet accident, le charbonnage fut classé dans la troisième catégorie des mines à grisou. Le sondage de la Hougaerde (Leernes) ne fut décidé qu'en 1906 et l’installation du siège numéro 3 le 31 janvier 1910. En plus des clouteries, fours à chaux et charbonnages, de nombreuses petites industries et entreprises commerciales existaient à Fontaine-l'Évêque. Le rapport communal de 1841 cite notamment : le charronnage, la boulangerie, la fabrication de chandelles, d'armes de luxe, la tannerie, la pannerie, la serrurerie, la vente d'étoffes, l'épicerie, la meunerie, la brasserie et les débits de boissons. Les industries du clou et du charbon allaient être favorisées par l'installation, à partir de 1864, d'une ligne de chemin de fer reliant Piéton à Marchienne-au-Pont et passant naturellement par Fontaine. Jusque-là, existaient deux services de diligences, l'un vers Marchienne-au-Pont, l'autre vers Mons par Binche. Le premier était exploité par Camille Bouillet et ensuite par sa veuve ; le second par Louis Villez, ensuite par sa fille Pauline, mariée en 1853 à Antoine Lebrun. Ceux-ci habitaient dans l'actuelle rue Benoît Fauconnier, à l'emplacement de l'ancienne boucherie Wincq, aujourd'hui démolie. Leur auberge possédait, outre une salle de café et une salle à manger des écuries et des chambres pour voyageurs; c'est aussi dans cette maison que naquit Benoît Fauconnier. Par la suite, le relais s’installa chez Louis Vilez, frère de Pauline au fond de la place communale, au coin du chemin conduisant maintenant au Château. Lorsque le service de diligences fut remplacé par la ligne de chemin de fer, le fils de Louis Vilez transforma ses transports de voyageurs en transports de marchandises ; il conduisait vers la gare de Marchienne-au-Pont les produits bruts et finis fabriqués dans les usines de Fontaine. (Renseignements fournis par M. Paul Thiry, petit-fils de Pauline Vilez, épouse Lebrun). Bientôt, au chemin de fer de Fontaine, vinrent s'ajouter des raccordements industriels et une station privée appartenant au charbonnage. La ville fut ainsi dotée d'un important réseau de communications qui fit immédiatement sentir ses effets. La population passa de 2.847 habitants en 1831 à 5.351 en 1880 et à 6.092 en 1910. Cette augmentation découla de l'arrivée dans les clouteries, de nombreuses familles venant de Thudinie et de l'Entre-Sambre-et-Meuse tandis que des mineurs flamands, après des voyages hebdomadaires en train finirent par se fixer à Fontaine avec les leurs. LA VIE SOCIALESi l'industrie était en plein essor dans notre cité, la situation des ouvriers n'était pas pour cela très brillante. Ils étaient logés dans des taudis et soumis à d'inhumaines conditions de travail. Les enfants du peuple allaient à l'usine ou à la fosse dès l'âge de 8 ans ; ils y faisaient des journées de 12, 13 et 14 heures, n’ayant de repos que le dimanche.
Les maigres salaires alloués ne permettaient à l'ouvrier et à sa nombreuse famille qu'une nourriture très pauvre : du pain, des légumes, des pommes de terre ; le beurre était rare, quant à la viande, on n’en mangeait que le dimanche ; encore s'agissait-il de morceaux de deuxième choix tels que bouilli ou lard. Dans le même temps, l'armée belge se constituait de la façon la plus scandaleuse. Dans chaque commune. un certain nombre de miliciens étaient appelés par le système de tirage au sort. Celui qui tirait un mauvais numéro devait partir soldat ; mais en versant 1.600 frs, les fils de riches se faisaient remplacer par des malheureux. A Fontaine, le tirage au sort avait lieu chaque année aux environs du mois de février pour les habitants des communes de Fontaine, Goutroux, Landelies, Leernes, Monceau, Montigny-le-Tilleul, Bellecourt, Chapelle, Forchies, Piéton, Souvret et Trazegnies. Il fallut attendre les lois sur l'instruction obligatoire, sur la journée de huit heures et sur le service militaire obligatoire, pour que ces iniquités disparaissent. LA VIE POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE
Plan (de mémoire) dressé par Louis
Delattre En 1852, mourut le dernier seigneur de Fontaine : Louis, duc de Brancas, grand d'Espagne et pair de France. Sa mésentente avec son épouse Caroline-Ghislaine, comtesse de Rodoan et baronne de Fontaine ainsi que les folles dépenses qu'ils opérèrent tous deux les avaient complètement ruinés. Le château fut vendu ; ainsi se clôturait la longue liste des seigneurs qui, pendant 700 ans, avaient marqué de leur empreinte l'histoire de notre ville. Entre-temps, l'ancien couvent des Récollets avait été acheté par la famille de Haussy qui le transforma en château. Le corps de logis occupait l'endroit devenu aujourd'hui l'hôtel de ville ; les écuries étaient construites là où se situe actuellement le théâtre communal ; les jardins du château sis où est installé le parc de la ville. François de Haussy, né en 1789, devint avocat, conseiller communal de Fontaine et sénateur. Il accéda en 1847 à la fonction de Ministre de la Justice. A cette époque, les partis politiques n'existaient pas sous la forme actuelle. Au 1er janvier 1840, sur une population de 2.908 habitants, il y avait seulement 55 électeurs pour les Chambres et 191 pour la formation du conseil communal ; seuls les fortunés avaient le droit de vote. La lutte politique locale se résumait donc à une rivalité de clans. En 1843, parmi les quatre écoles privées établies dans la ville, deux furent adoptées pour servir d'écoles communales : celle du sieur Jean Leclercq pour les garçons et celle d'Antoine Leroy pour les filles. Dans la première, 90 garçons « pauvres » étaient admis pour y recevoir l'instruction gratuite et 84 filles « pauvres » dans la seconde. On peut évaluer que les autres écoles recevaient en outre un nombre moyen de deux cents élèves « payants ». En cette même année 1843 fut pratiquement achevée la route d’Anderlues à Courcelles, réclamée en 1819 par les Fontainois pour le transport de leurs fabrications industrielles. C'est en 1847 que s'installa le couvent des sœurs de Ste Marie ; elles venaient de Namur à la demande de Mme Ghislain-Bouly qui désirait voir s'établir dans la ville une institution de religieuses vouées à l'enseignement. Cette dame fournit les fonds pour l'achat d'un établissement convenable.
Le couvent des sœurs de Ste Marie En 1851, le Conseil Communal proposa de tirer parti d'une source perdue à l'endroit dit « Le Berger » ; il décida l'établissement d'un train de fontaine pour apporter des provisions d’eau aux habitants des quartiers de l'Esplanade et de la rue de Leernes. C'est à cette époque que furent opérés les nivellements des remparts, notamment ceux des religieuses (rue de Haussy) et de la Bouverie (boulevard du Nord). En 1855, la communication avec la commune de Piéton fut améliorée par l'aménagement d'un chemin empierré remplaçant les divers sentiers qui filaient à travers champs. La ville continuant à se développer, le « vieux cimetière » situé entre la rue de la Babelonne et la rue des Houillères se trouva trop exigu, surtout trop proche des habitations. Dans un but de salubrité publique, i1 fut décidé, en 1875, de le remplacer par un nouveau, à l'endroit appelé « champ de la Blanche Maison ». Le hameau des Gaulx était relié au centre de Fontaine par un sentier qui, partant de la ruelle Luton, traversait les prairies de la rue des Déportés qui n'existait pas encore, et allait rejoindre la rue Verte (rue du Parc) au-dessus de la propriété du Docteur Denamur. En août 1878, le rempart des religieuses ayant été nivelé, le Conseil communal sollicita un emprunt pour créer un chemin empierré reliant la porte du Marteau (bas de la rue de Haussy) à la ruelle Luton, chemin qui devait devenir par la suite l'avenue des Déportés. En 1881, fut construite une école communale de 6 classes « dans la partie haute de la ville ». Il s'agissait de l'école primaire pour filles, installée rue Paul Pastur et qui fut démolie en 1956 pour faire place à l’école Léo Collard. Elle comprenait 2 classes gardiennes autonomes et 4 classes primaires. Un vaste préau séparait les deux écoles. A front de rue, entre les maisons des chefs d'école était établie une école ménagère. La première institutrice en chef fut Melle Remv ; lui succédèrent chronologiquement Mme Leclercq, Melle Ledoux, Melle Manderlier, Mme Gusbin et aujourd’hui, Mme Delsarte. C'est aussi en 1881 que la Cie Téléphone Bell reçut l'autorisation du Conseil Communal d'installer des lignes téléphoniques au-dessus du territoire de la ville. L'année suivante s'ouvrit à Fontaine une école moyenne pour garçons qui débuta avec 12 élèves; elle en accueillit 70 en 1883 ; 75 en 1884 ; 95 en 1885 et 100 en 1886. Le 10 août 1886, le Conseil communal décida la création d'une école industrielle et commerciale qui commença l'année suivante avec 59 élèves. Les différents directeurs furent MM. Collinge de 1887 à 1893, Hippolyte Cornille de 1893 à 1921, René Delcourt de 1921 à 1952 et Aurélien Dumont depuis 1952. Elle compte aujourd'hui plus de 500 élèves. En sa séance du 8 janvier 1896, il fut donné lecture au Conseil communal d'une pétition de MM. Joseph Parée et consorts relative à la création et à l'emplacement d'une école gardienne et d'une place publique à l'important hameau des Gaulx. A la suite de cette requête, le Conseil décide le 6 mars 1897, la création de la place des Gaulx par l'acquisition de 23 ares de terrain appartenant à M. Gédéon Genin ; le 1er octobre 1899, l'école gardienne ouvrait ses portes avec une population de 31 garçons et 17 filles. Par arrêté royal du 7 mars 1898, la ville de Fontaine-l’Évêque fut autorisée à reprendre ses anciennes armoiries qui sont « d'or, à l'aigle de sable lampassée et onglée de gueules, à une cotice de gueules brochant sur le tout ». Toujours en 1898, l'administration communale décida de faire les démarches nécessaires pour l'établissement d'un chemin de fer vicinal allant d’Anderlues à Trazegnies par Fontaine. Celui-ci fut mis en service en 1907.
En 1900, l'éclairage public au gaz dû à P. C. Montigny comprenait 177 lanternes ; le hameau de Beaulieusart qui ne possédait aucune conduite de gaz était éclairé par 36 lampes au pétrole. C'est le 9 septembre 1900 que fut inauguré l'hôpital communal en présence du gouverneur de la Province du Hainaut. Le 31 juillet 1909 eut lieu à la place de l’Esplanade, l'inauguration du kiosque dû à la générosité de M. Adolphe Otlet, industriel local.
En 1911, s’ouvrit une école gardienne communale au hameau de Beaulieusart. En 1912, la petite-fille du ministre de Haussy vendit à la ville le domaine des de Haussy ; le corps de logis fut transformé en hôtel de ville ; les écuries devinrent salle des fêtes communale quelques années plus tard. L'ancien hôtel de ville (Palais de Justice) avait subi un incendie partiel en 1911. Dès 1913, les travaux de reconstruction étaient terminés et les services de police fonctionnaient au rez-de-chaussée tandis que le tribunal de Justice de Paix siégeait au premier étage. Il en est encore ainsi aujourd'hui.
Le palais de Justice Quant à l'éclairage public, il avait fortement progressé puisqu'à la veille de la guerre, il comptait 648 lanternes dont 409 lampes électriques et 239 becs Auer. |